Chapitre 2 Riche héritage (PDF)
File information
This PDF 1.4 document has been generated by Writer / OpenOffice 4.0.1, and has been sent on pdf-archive.com on 15/03/2015 at 20:33, from IP address 92.158.x.x.
The current document download page has been viewed 575 times.
File size: 115.71 KB (12 pages).
Privacy: public file


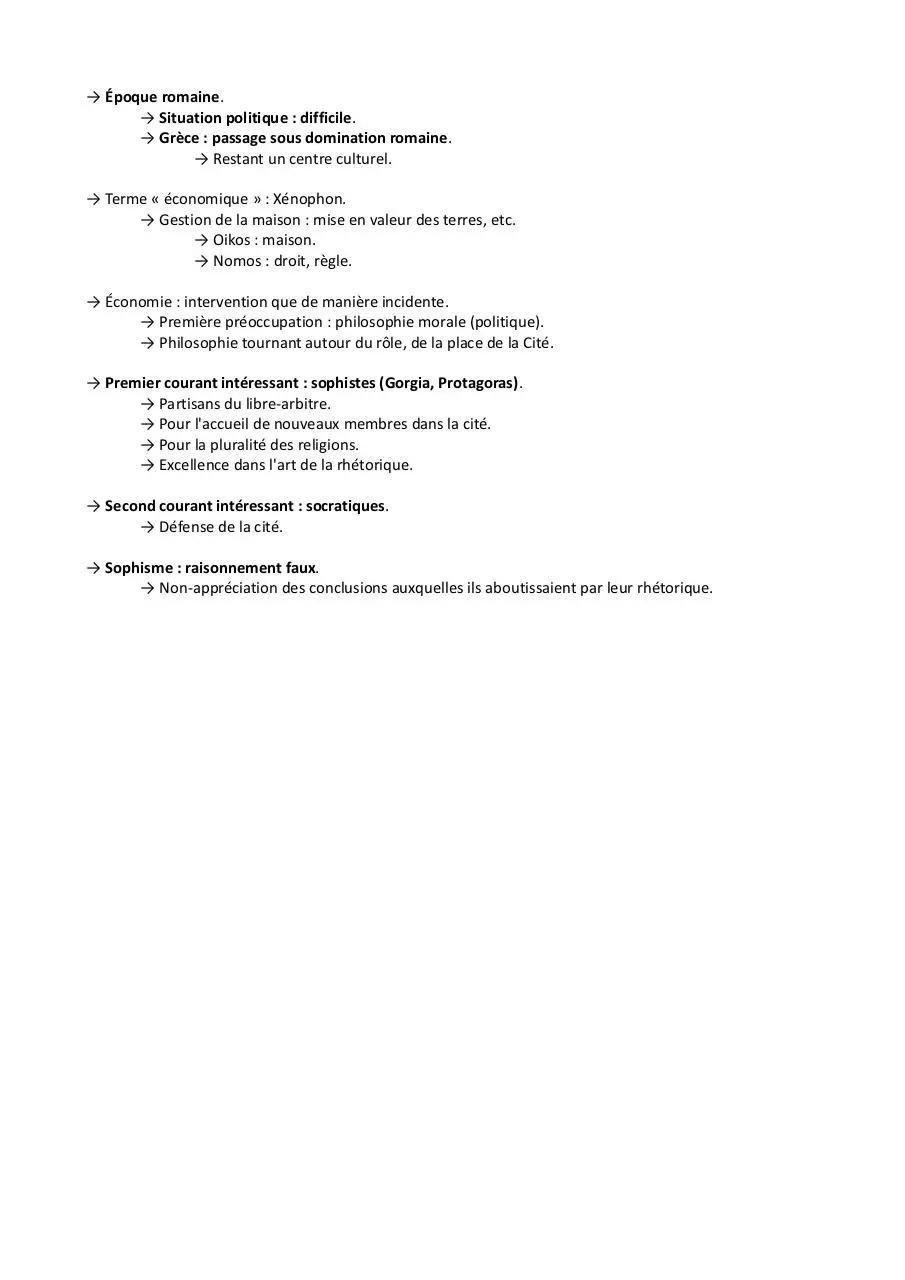
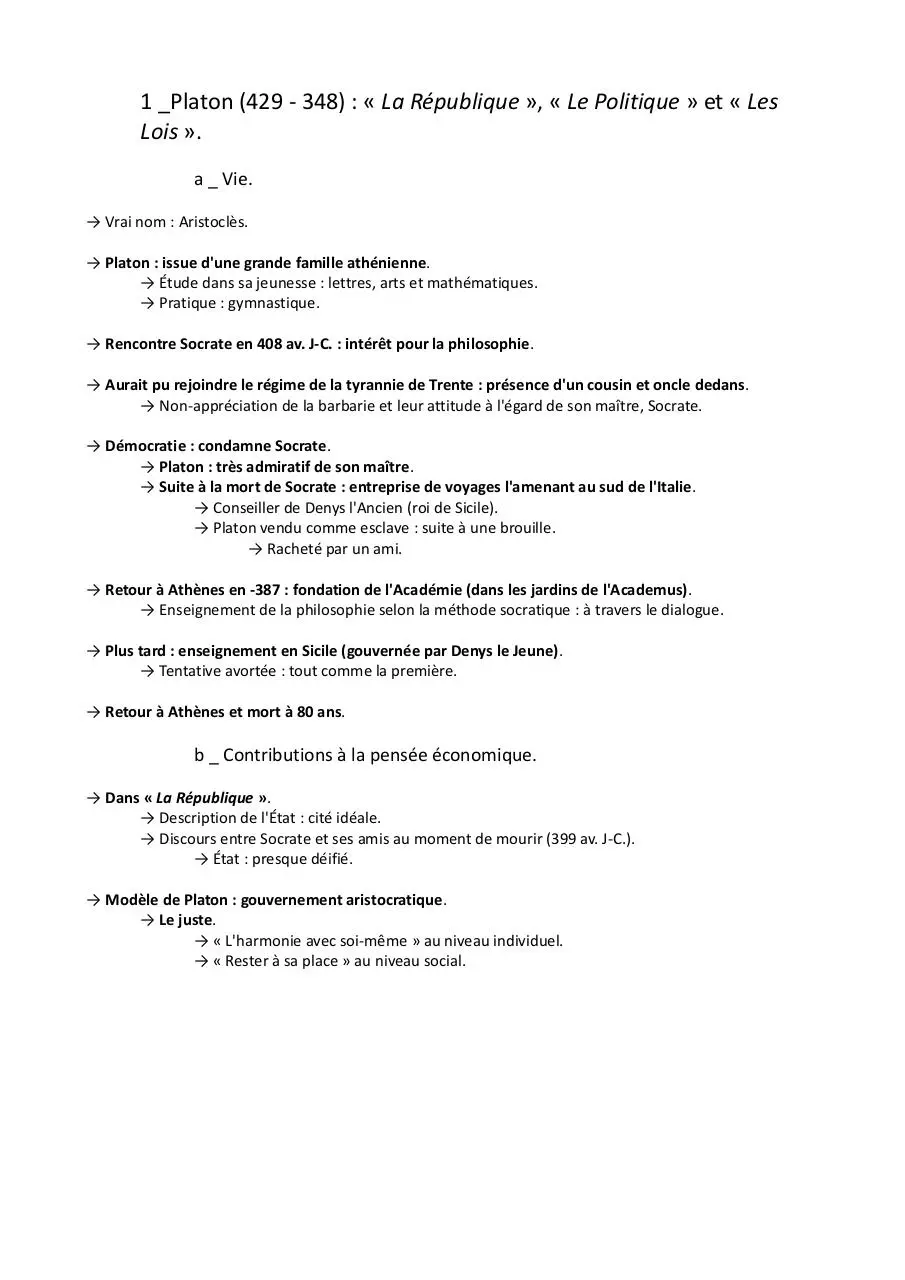
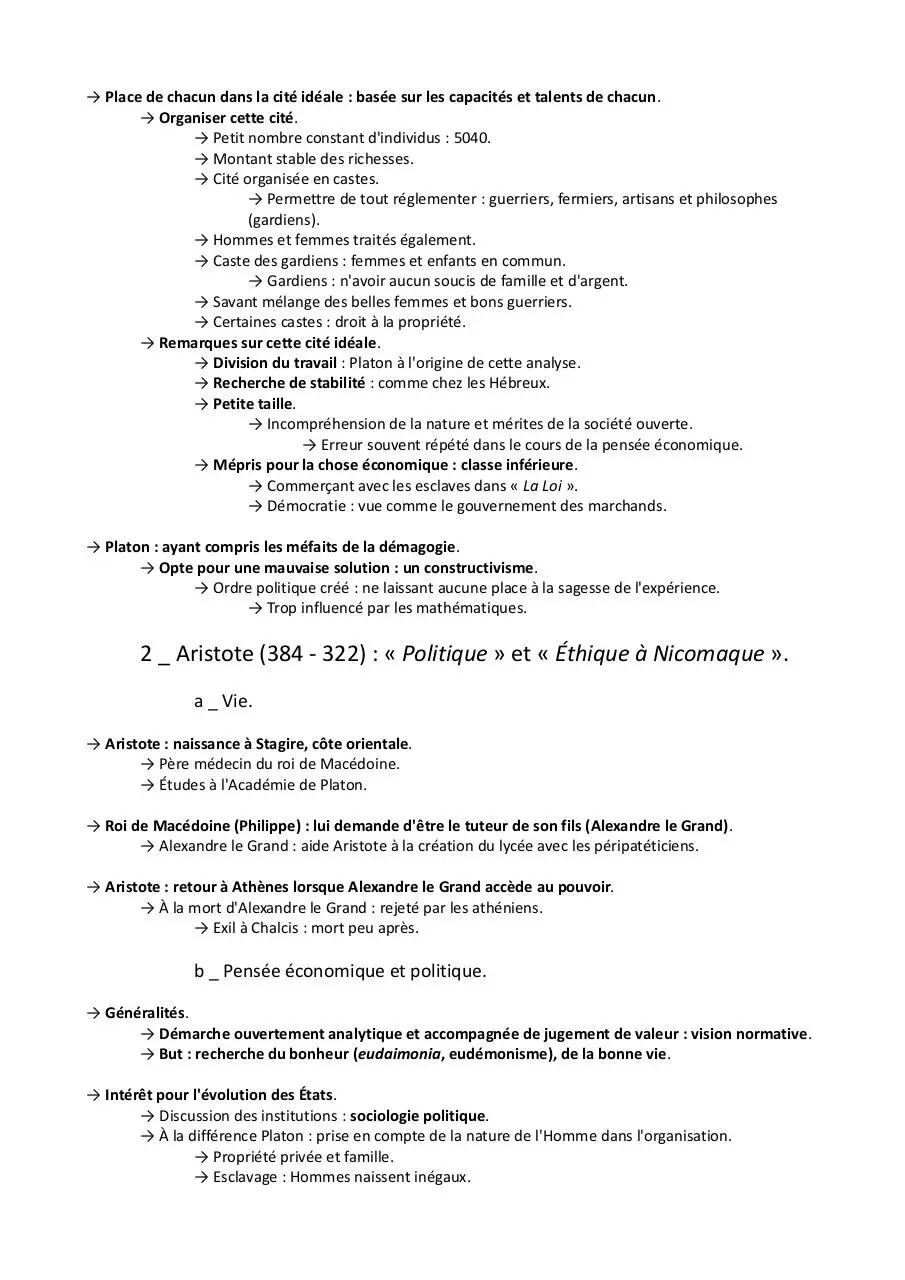
File preview
Économie et management.
Licence 2.
Histoire de la pensée économique.
Année
2014 - 2015
Chapitre 2 :
Riche héritage
Pierre Garello.
I _ Philosophes de la cité.
→ Époque archaïque : à partir du VIIème siècle av. J-C.
→ Apparition des cités, petits territoires indépendants et politiquement structurés.
→ Population : forte augmentation.
→ Création de colonies grecques : îles de la mer Égée, Asie mineure et autres régions
méditerranéennes.
→ Grands penseurs : souvent d'outre-mer.
→ Thalès et Xénophane : Asie.
→ Pythagore : fondation d'une école en Italie du Sud.
→ Naissance de la Grande Grèce.
→ Guerre létantine (de -710 à -650) : conflit continuel entre cités grecques.
→ Un des premiers affrontements de la Grèce antique documenté.
→ Affrontement : cités-états de Chalcis et d'Eretria sur la Lélantine (plaine fertile de
l'Eubée).
→ Développement d'une classe marchande : première moitié du VIIème siècle av. J-C.
→ Apparition de monnaies grecques vers -680 : tensions entre les villes.
→ Classes aristocratiques gouvernant les cités : menacées par cette nouvelle bourgeoisie de
marchands souhaitant se lancer dans la politique.
→ À partir de -650 : lutte pour éviter d'être renversée par des tyrans populistes.
→ Tyran : terme grec signifiant « dirigeant illégitime ».
→ Époque classique : début du Vème siècle av. J-C.
→ Grecs : repoussent les troupes de l'immense Empire perse lors des guerres médiques.
→ Bataille de Salamine (480 av. J-C.) : assurance de l’hégémonie de la Grèce en mer Égée.
→ Âge d'or de la Grèce.
→ Penseurs : inauguration de nouvelles manières d'envisager le monde.
→ Athènes : mise en place d'une démocratie.
→ Occupation d'une place prépondérante sur les plans politique et artistique.
→ Développement de la tragédie.
→ Socrate : presque jamais quitté la ville.
→ Après la guerre du Péloponnèse (de -431 à -404) : Athènes contre Sparte.
→ Affaiblissement des cités grecques.
→ Vie intellectuelle vivace : Platon et Aristote.
→ Vers 338 av. J.C. : domination de la Grèce par la Macédoine.
→ Entre 336 et 323 : Alexandre le Grand conquiert un immense empire.
→ Époque hellénistique.
→ À la mort d'Alexandre le Grand : empire partagé entre ses anciens généraux.
→ Ptolémée, Séleucos, Lysimaque, Antigone le Borgne : souverains absolus sur de vastes
régions.
→ Antigonides : conservation de la Macédoine.
→ Séleucides : Asie et ancien empire perse.
→ Influences grecques : jusque dans les sculptures bouddhiques d'Afghanistan.
→ Ptolémées : domination de l’Égypte.
→ Alexandrie : haut lieu du savoir.
→ Grèce : développement de nouvelles philosophies.
→ Épicurisme.
→ Stoïcisme.
→ Époque romaine.
→ Situation politique : difficile.
→ Grèce : passage sous domination romaine.
→ Restant un centre culturel.
→ Terme « économique » : Xénophon.
→ Gestion de la maison : mise en valeur des terres, etc.
→ Oikos : maison.
→ Nomos : droit, règle.
→ Économie : intervention que de manière incidente.
→ Première préoccupation : philosophie morale (politique).
→ Philosophie tournant autour du rôle, de la place de la Cité.
→ Premier courant intéressant : sophistes (Gorgia, Protagoras).
→ Partisans du libre-arbitre.
→ Pour l'accueil de nouveaux membres dans la cité.
→ Pour la pluralité des religions.
→ Excellence dans l'art de la rhétorique.
→ Second courant intéressant : socratiques.
→ Défense de la cité.
→ Sophisme : raisonnement faux.
→ Non-appréciation des conclusions auxquelles ils aboutissaient par leur rhétorique.
1 _Platon (429 - 348) : « La République », « Le Politique » et « Les
Lois ».
a _ Vie.
→ Vrai nom : Aristoclès.
→ Platon : issue d'une grande famille athénienne.
→ Étude dans sa jeunesse : lettres, arts et mathématiques.
→ Pratique : gymnastique.
→ Rencontre Socrate en 408 av. J-C. : intérêt pour la philosophie.
→ Aurait pu rejoindre le régime de la tyrannie de Trente : présence d'un cousin et oncle dedans.
→ Non-appréciation de la barbarie et leur attitude à l'égard de son maître, Socrate.
→ Démocratie : condamne Socrate.
→ Platon : très admiratif de son maître.
→ Suite à la mort de Socrate : entreprise de voyages l'amenant au sud de l'Italie.
→ Conseiller de Denys l'Ancien (roi de Sicile).
→ Platon vendu comme esclave : suite à une brouille.
→ Racheté par un ami.
→ Retour à Athènes en -387 : fondation de l'Académie (dans les jardins de l'Academus).
→ Enseignement de la philosophie selon la méthode socratique : à travers le dialogue.
→ Plus tard : enseignement en Sicile (gouvernée par Denys le Jeune).
→ Tentative avortée : tout comme la première.
→ Retour à Athènes et mort à 80 ans.
b _ Contributions à la pensée économique.
→ Dans « La République ».
→ Description de l'État : cité idéale.
→ Discours entre Socrate et ses amis au moment de mourir (399 av. J-C.).
→ État : presque déifié.
→ Modèle de Platon : gouvernement aristocratique.
→ Le juste.
→ « L'harmonie avec soi-même » au niveau individuel.
→ « Rester à sa place » au niveau social.
→ Place de chacun dans la cité idéale : basée sur les capacités et talents de chacun.
→ Organiser cette cité.
→ Petit nombre constant d'individus : 5040.
→ Montant stable des richesses.
→ Cité organisée en castes.
→ Permettre de tout réglementer : guerriers, fermiers, artisans et philosophes
(gardiens).
→ Hommes et femmes traités également.
→ Caste des gardiens : femmes et enfants en commun.
→ Gardiens : n'avoir aucun soucis de famille et d'argent.
→ Savant mélange des belles femmes et bons guerriers.
→ Certaines castes : droit à la propriété.
→ Remarques sur cette cité idéale.
→ Division du travail : Platon à l'origine de cette analyse.
→ Recherche de stabilité : comme chez les Hébreux.
→ Petite taille.
→ Incompréhension de la nature et mérites de la société ouverte.
→ Erreur souvent répété dans le cours de la pensée économique.
→ Mépris pour la chose économique : classe inférieure.
→ Commerçant avec les esclaves dans « La Loi ».
→ Démocratie : vue comme le gouvernement des marchands.
→ Platon : ayant compris les méfaits de la démagogie.
→ Opte pour une mauvaise solution : un constructivisme.
→ Ordre politique créé : ne laissant aucune place à la sagesse de l'expérience.
→ Trop influencé par les mathématiques.
2 _ Aristote (384 - 322) : « Politique » et « Éthique à Nicomaque ».
a _ Vie.
→ Aristote : naissance à Stagire, côte orientale.
→ Père médecin du roi de Macédoine.
→ Études à l'Académie de Platon.
→ Roi de Macédoine (Philippe) : lui demande d'être le tuteur de son fils (Alexandre le Grand).
→ Alexandre le Grand : aide Aristote à la création du lycée avec les péripatéticiens.
→ Aristote : retour à Athènes lorsque Alexandre le Grand accède au pouvoir.
→ À la mort d'Alexandre le Grand : rejeté par les athéniens.
→ Exil à Chalcis : mort peu après.
b _ Pensée économique et politique.
→ Généralités.
→ Démarche ouvertement analytique et accompagnée de jugement de valeur : vision normative.
→ But : recherche du bonheur (eudaimonia, eudémonisme), de la bonne vie.
→ Intérêt pour l'évolution des États.
→ Discussion des institutions : sociologie politique.
→ À la différence Platon : prise en compte de la nature de l'Homme dans l'organisation.
→ Propriété privée et famille.
→ Esclavage : Hommes naissent inégaux.
→ Esclavage.
→ Tom Palmer : position d'Aristote sur ce point plus complexe qu'il n'y paraît.
→ Aristote : distinction de deux types d'esclavage.
→ Esclavage « de nature » : seul acceptable.
→ Esclavage fait de l'Homme.
→ Propriété : défendue par Aristote.
→ Contrairement à Platon.
→ Division des tâches un peu malsaine.
→ Recherche de la société idéale pour Platon : serait communiste.
→ Aristote : propriété nécessaire car l'Homme est faible.
→ Propriété : pas tout à fait morale.
→ Collectivisme : possibilité d'occuper seul la prétention à une théorie totalement
juste.
→ « Politique » : différence entre privée et commun dans sa société idéale.
→ Défense de la propriété car efficace.
→ Propriété : devrait être commune d'une certaine façon.
→ En règle générale : doit être confiée au privé.
→ Lorsque chacun a un intérêt bien spécifié : plus de reproches.
→ Progrès : occupation par chacun de ses propres affaires.
→ Monnaie : bon et mauvais usage de la chose.
→ Bon : utiliser la monnaie pour les échanges.
→ Histoire de l'apparition de la monnaie chez Aristote.
→ Usage « nécessaire » de la monnaie : passage à l'usage de la monnaie par le détaillant.
→ « The art of money-making ».
→ Commerce de détail : pas une forme naturelle de l'art de faire de l'argent.
→ Distinction entre : chrématistique.
→ Nécessaire : monnaie moyen d'échange.
→ Pure : recherche de la richesse en soi.
→ Pire des commerces : prêt à intérêt ou usure.
→ Gain à partir de l'argent et non à partir d'un usage naturel de cet argent.
→ Valeur et prix.
→ Distinction : valeur.
→ D'usage : théorie psychologique.
→ D'échange : plus ou moins dépendante de l'usage.
→ Définition du monopole : considéré comme injuste.
→ Prix juste : celui de la concurrence.
→ Relevant d'une justice commutative : équivalence des services.
→ Par opposition à une justice distributive.
→ Justice des échanges : opposition.
→ Justice commutative : équivalence des services.
→ Justice distributive : équivalence des résultats.
→ Préférée de Platon.
→ Opposition importante entre les deux philosophes grecs.
→ Justice de résultat ou procédurale.
→ Grecs : idéal de l'homme demeurant l'aristocrate (noble).
→ Aristote : condamnation du profit et de l'usure.
→ Non-naturels.
II _ Apport des penseurs romains.
→ Némo : « À l'organisation politique de la société développée par les Grecs, les Romains vont ajouter
quelque chose de leur crû : le droit. Cicéron va faire le lien entrer la philosophie stoïcienne qui porte à
l'universalisme et le droit romain qui avant lui est très concret ; il va faire du droit romain un droit abstrait ».
→ Pensée romaine : inscription dans la continuité de la pensée grecque.
→ Apport résidant dans leur réflexion sur le droit : preuve de leur capacité d'analyse scientifique.
→ Aucune analyse économique chez les Romains.
→ Travaux juridiques : extrême importance pour la vie économique.
→ Peu de réflexions purement économiques.
→ Questions économiques : plutôt méprisées par la haute société romaine.
→ Métiers de nobles.
→ Guerrier : militaire.
→ Homme politique.
→ Conseiller en matière juridique : vers la fin de l'empire.
→ Ouvrages sur l'économie agricole : conseils sur la gestion pratique d'une exploitation.
→ Droit romain : émergences et évolutions de règles destinées à une société ouverte.
→ Présence de deux droits au départ.
→ Jus civile : concernant uniquement les citoyens romains.
→ Jus gentium : concernant les rapports entre non-citoyens ou entre citoyens et
non-citoyens.
→ Droit de tous : proche de la notion de droit naturel.
→ Présence d’administrateurs publics : pas de juristes professionnels.
→ Conseillers juridiques (spécialistes de la loi) : apparition après Jules César.
→ Statut officiel.
→ Droit romain : première codification véritable.
→ Sous l'impulsion de l'empereur Justinien I er (482 - 565).
→ Naissance : Corpus Juris Civilis.
→ Novelles (novellou) : nouveautés introduites récemment parmi les statuts de l'empire.
→ Instituts (institutions) : recueil plus ancien de textes de Graïus (sert à l'enseignement).
→ Code (codex) : regroupant et harmonisant les autres codes de l'empire.
→ Digeste (digestur) : analyses d'experts en matière juridique.
→ Seul travail vraiment analytique des phénomènes sociaux légué par les romains.
→ Corpus Juris : idées économiques.
→ Définition de concepts utiles à la vie économique : sur lesquels s'appuient les analyses
juridiques.
→ Prix, monnaie, différents types de prêts, propriété, personne morale, droit, etc.
→ Idée même de droit au sens moderne du terme.
→ Règles universelles et abstraites : application à tous et dans un grand nombre de
circonstances.
→ Règles permettant de résoudre : grand nombre de conflit d'une façon prévisible.
→ Différence : réflexions des penseurs grecs et juristes romains.
→ Penseurs grecs : sens de l'universalité et de la nature de l'Homme.
→ Système politique : non-conçu pour une société ouverte.
→ Romains : clefs d'une coopération entre un grand nombre d'individus composant une société
largement ouverte.
→ Chute de l'empire romain : en 476.
→ Rumulus Augustule : dernier empereur.
→ Invasions barbares : Wisigoths et Vandales.
→ Chute de l'empire romain : causes.
→ Bas Empire (285 - 565) : monarchie absolue de droit divin.
→ Effet important de centralisation et hiérarchisation administrative.
→ Étouffant la vie politique et économique de l'empire.
→ Point de vue économique : dirigisme omniprésent.
→ Étatisation de l'économie.
→ Édit du Maximum : fixation du prix maximum de plusieurs centaines de produits.
→ Salaires compris.
→ Droits de la propriété : quiconque promet d'exploiter une terre peut s'y installer.
→ Sans se soucier de savoir si elle a un propriétaire.
→ État : développement de manufactures impériales protégées par monopole officiel.
→ Armureries, papeteries, tissage, monnaie, etc.
→ Autres professions : souvent organisées en corporations protégées.
→ En Orient : meilleure résistance des empereurs Théodose et Justinien.
→ Jusqu'à l'invasion de Constantinople par les Turcs en 1453.
→ Constantin : tolérance officielle du christianisme.
→ Baptisé sur son lit de mort.
→ Christianisme : religion officielle de l'empire d'orient un peu plus tard.
→ Césaro-papisme.
→ Cicéron (106 - 43).
→ Un des pères de la doctrine du « Rule of Law ».
→ Inspiré des auteurs grecs et stoïciens.
→ Avocat et homme politique (consul en 63).
→ En 49 : franchissement du Rubicon par César et installation de la dictature.
→ Après assassinat de César : espère un retour de la République.
→ Avènement d'Antoine.
→ Cicéron traqué et égorgé en 43.
→ Très lu : réputé écrire dans une langue parfaite.
→ Une des principales sources de l'humanisme occidental.
→ « Le droit se fonde non sur l'opinion mais sur la nature ».
→ Droit positif, de l'État : ne doit pas contredire le droit naturel.
III _ Pensée judéo-chrétienne.
1 _ Peuple hébreu.
→ Peuple hébreu : double intérêt.
→ Une des sources de la pensée occidentale (judéo-chrétienne).
→ Disposition de quelques informations écrites à travers les livres de l'Ancien Testament.
→ « Biblos » : le livre.
→ Une partie des écrits composant la Bible : présents dans la Torah.
→ Torah : le plus saint des textes sacrés du judaïsme.
→ « Torah » : instruction.
→ Instructions laissées par Dieu au peuple.
→ Attitude positive à l'égard du travail : emploi digne.
→ Contrairement aux grecs et romains.
→ Commandement de Dieu dans la Genèse : « Tu domineras la terre ! ».
→ Fils et filles de Dieu : co-créateurs avec leur Dieu.
→ Reconnaissance de la propriété privée.
→ Exode, verset 20 « Les dix commandements ».
→ Tu ne voleras pas.
→ Tu ne convoiteras pas la maison de ton voisin, ni sa femme, ni ses servants, ni son bétail,
ni quoique ce soit qui lui appartienne.
→ Lévitique : autre livre de Pentateuque.
→ La terre ne sera pas vendue avec perte de tout droit, car la terre m'appartient et vous
n'êtes pour moi que des étrangers et des hôtes.
→ Sanctions prévues pour le vol.
→ Si vol et meurtre d'un mouton : il faut en restituer quatre.
→ Désir de protéger les pauvres.
→ Prêter de l'argent à pauvre : pas exiger d'intérêt.
→ Demander un gage : lui rendre avant le soir.
→ Après récolte : laisser une partie derrière soi.
→ Pour que le pauvre puisse venir se servir.
→ Lévitique : Année sabbatique et année jubilaire.
→ Tous les 7 ans : en souvenir du repos de Dieu le septième jour.
→ Terre laissée au repos tous les sept sabbats.
→ Tous les 49 ans : terre retournant au propriétaire d'origine.
→ Sauf : maison à l'intérieur d'une enceinte.
→ Prix des terres : calculés en conséquence.
→ Terre à faible prix une année avant le jubilé.
→ Année sabbatique : remettre les dettes (sauf aux étrangers).
→ Esclave hébreu : le rendre libre et lui donner de quoi subsister.
Download Chapitre 2 - Riche héritage
Chapitre 2 - Riche héritage.pdf (PDF, 115.71 KB)
Download PDF
Share this file on social networks
Link to this page
Permanent link
Use the permanent link to the download page to share your document on Facebook, Twitter, LinkedIn, or directly with a contact by e-Mail, Messenger, Whatsapp, Line..
Short link
Use the short link to share your document on Twitter or by text message (SMS)
HTML Code
Copy the following HTML code to share your document on a Website or Blog
QR Code to this page
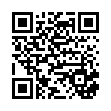
This file has been shared publicly by a user of PDF Archive.
Document ID: 0000215343.